
GIR 3 : définition, aides et évaluation de l'autonomie
L'un de vos proches vient d'être évalué en GIR 3 suite à l'analyse de son dossier de demande et vous cherchez à comprendre ce que cela signifie concrètement ? Il est normal de se sentir un peu perdu. Ce classement, issu de la grille AGGIR, est une étape clé pour évaluer le degré de perte d'autonomie d'une personne âgée et déterminer sa condition pour accéder à une prise en charge adaptée.
Ce guide est conçu pour vous éclairer. Nous allons expliquer ce que le GIR 3 change, comment son niveau est déterminé par un médecin, et surtout, quelles sont les solutions, comme l'APA, dont votre parent pourra bénéficier pour continuer à vivre dans son lieu de vie le mieux possible. Vous saurez tout sur le montant mensuel disponible et les démarches à effectuer.
- Le GIR 3 indique une perte d'autonomie partielle, principalement physique (toilette, habillage), avec des capacités mentales conservées.
- L'évaluation du GIR 3 est réalisée par une équipe médico-sociale via la grille AGGIR, observant les actions quotidiennes de votre proche.
- Ce classement ouvre droit à l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), aide principale finançant un programme de soutien sur mesure.
- Le montant plafond de l'APA pour un GIR 3 est de 1 143,09€ (2024), avec une participation variable selon les revenus.
- Des aides complémentaires existent : crédit d'impôt, caisses de retraite, CCAS et subventions de l'Anah pour l'aménagement du domicile.
- Les solutions incluent le maintien à domicile avec des prestations adaptées, ou des hébergements intermédiaires comme les résidences seniors.
À quoi correspond exactement le GIR 3 ?
Le classement en GIR 3 correspond à une perte d'autonomie partielle. Sur l'échelle de la grille AGGIR, qui évalue le degré de dépendance, ce niveau indique que votre parent a besoin d'une assistance régulière pour certains actes de la vie courante, mais reste partiellement autonome.
Une caractéristique majeure du GIR 3 est que les facultés mentales sont généralement conservées. Votre parent reste lucide, orienté dans le temps et l'espace, et capable de prendre des décisions. La perte d'autonomie concerne majoritairement l'aptitude motrice et l'hygiène corporelle, l'incapacité locomotrice n'étant pas totale.
Les besoins d'assistance se concentrent sur des gestes précis, qui nécessitent une présence souvent plusieurs fois par jour. Il s’agit par exemple :
- de l’aide pour la toilette (douche, bain, soins d’hygiène)
- de l’habillage (choisir les vêtements, boutonner, enfiler certaines pièces)
- de la préparation des repas et parfois de l’aide à la prise alimentaire
- du ménage ou de l’entretien courant de l’habitat
- de l’accompagnement pour les sorties extérieures (courses, rendez-vous médicaux)
En revanche, la personne peut encore accomplir de nombreuses choses seule. Par exemple, elle est souvent capable de se déplacer seule à l'intérieur de sa maison sans difficulté majeure. Elle peut se lever, marcher ou s'asseoir sans présence extérieure, ce qui est un atout majeur pour rester à domicile.
Pour situer ce niveau, le GIR 3 représente un degré de dépendance moins lourd que les GIR 1 et 2 (personnes confinées au lit ou au fauteuil). La dépendance est cependant plus marquée que pour les GIR 4, 5 et 6, où la personne est considérée comme plus autonome pour les actes courants.
Comment le niveau de GIR de mon proche est-il évalué ?
L'évaluation du niveau de GIR n'est pas un simple avis médical. C'est une démarche officielle et structurée, qui se réalise par une équipe médico-sociale envoyée par le conseil départemental. Le plus souvent, cette évaluation se déroule directement au domicile de la personne. Cela permet aux professionnels d'observer la personne dans son environnement habituel.
L'outil utilisé est la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources). Il s'agit d'un questionnaire standardisé qui permet de mesurer le degré de dépendance de manière objective et uniforme sur tout le territoire. L'évaluateur observe la capacité de votre parent à effectuer 10 activités corporelles et mentales de la vie courante.
À titre d'exemple illustrative, l'équipe s'intéresse particulièrement à :
- la capacité à se nourrir seule
- la possibilité de se lever, se coucher, se déplacer à l’intérieur
- la continence (utiliser les toilettes de manière autonome)
- la communication (parler, comprendre, interagir)
- l’orientation dans le temps et l’espace
- la capacité à gérer sa sécurité (par exemple, ne pas oublier d’éteindre le gaz)
Un point à retenir : cette évaluation est dite discriminante, car elle porte sur ce que votre parent fait ou ne fait pas seul. Elle ne juge pas ce qu'il pourrait faire en théorie. Si une activité n'est pas réalisée correctement et en totalité, elle est considérée comme non acquise. Notre conseil est de bien préparer cette visite.
Votre présence en tant que proche aidant lors de cette visite est fortement recommandée. Vous connaissez la vie de votre parent mieux que personne. Vous pourrez apporter des précisions sur ses difficultés réelles, ses habitudes et son état de santé général. Votre témoignage est une ressource utile pour que l'évaluation soit la plus juste possible.
Quelles aides financières avec un GIR 3, notamment l'APA ?
La confirmation d'un classement en GIR 3 est une étape déterminante, car elle ouvre droit au principal soutien pécuniaire pour la perte d'autonomie : l'Allocation d'Autonomie (APA). Cette aide est spécifiquement conçue pour une personne classée du GIR 1 au GIR 4.
Dans le cadre de l'APA à domicile, l'allocation ne correspond pas à une somme versée directement sur un compte bancaire. Elle finance un programme d'accompagnement sur mesure, établi par l'équipe médico-sociale du département. Ce dispositif liste les prestations et équipements nécessaires pour assister votre parent.
Ce programme de soutien peut prendre en charge différentes prestations. À titre d'exemple, on y retrouve :
- l’intervention d’aides à domicile pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas
- la livraison de repas à domicile (portage de repas)
- un service de téléassistance pour la sécurité
- l’aide au ménage et à l’entretien du logement
- l’aménagement du logement (barres d’appui, siège de douche, lit médicalisé)
- le financement de matériel médical ou de produits d’incontinence
Le montant mensuel plafond de l'APA pour un GIR 3 est fixé par décret à 1 143,09 euro (valeur en 2024). Attention, il s'agit d'un maximum. Une participation (aussi appelée ticket modérateur) peut rester à la charge de votre parent. Son montant est variable car il est calculé en fonction de ses revenus.
Si votre parent vit en établissement, comme un EHPAD, l'APA en établissement fonctionne différemment. L'allocation sert alors à régler une partie des frais de la facture de l'hébergement, plus précisément la partie correspondant au tarif dépendance. Cette prise en charge est généralement versée directement à la maison de retraite.
Existe-t-il d'autres aides en plus de l'APA ?
Oui, l'APA est le soutien principal, mais ce n'est pas le seul. Une fois le programme de soutien défini, il reste souvent une partie des frais à votre charge. D'autres dispositifs comme l'aide sociale existent pour alléger cette dépense et financer des projets spécifiques, comme l'aménagement du domicile.
Pensez d'abord au crédit d'impôt pour les services à la personne. C'est un soutien fiscal très efficace. Vous pouvez déduire 50% des dépenses que vous payez réellement pour une assistance à domicile, une fois l'APA déduite. C'est une réduction directe sur vos impôts. Vous trouverez plus d'informations sur la page du service public.
Contactez également les caisses de retraite de votre parent, la principale comme la complémentaire. Beaucoup proposent des "plans d'action sociale" pour leurs retraités. Elles peuvent financer des heures d'aide ménagère, des soutiens techniques ou d'autres prestations favorisant la vie à domicile.
Ne négligez pas l'échelon local. Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), présent dans chaque mairie, est une ressource précieuse. Les soutiens varient d'une commune à l'autre, mais le CCAS peut proposer des appuis financiers ponctuels ou des prestations spécifiques pour les personnes âgées de la ville.
Enfin, si des travaux sont nécessaires pour sécuriser l'habitation, tournez-vous vers l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah). Notre conseil : cet organisme propose des subventions pour financer des travaux d'aménagement. Par exemple, pour remplacer une baignoire par une douche de plain-pied ou installer un monte-escalier.
Quelles solutions de vie et d'accompagnement envisager ?
Avec un classement en GIR 3, plusieurs solutions sont possibles. Le choix dépendra avant tout des souhaits de votre parent, de son état de santé global et de son environnement. Rester chez soi est souvent la solution privilégiée et tout à fait réalisable.
Grâce au programme de soutien sur mesure, il est possible de structurer un accompagnement solide pour que votre parent puisse rester chez lui en toute sécurité. L'objectif est de compenser sa perte d'autonomie avec des prestations ciblées. Les dispositifs clés à organiser sont :
- une aide à domicile régulière (auxiliaire de vie, aide-ménagère)
- un suivi médical adapté avec passage d’infirmiers
- la mise en place d’un système de téléassistance
- le portage de repas ou l’accompagnement aux courses
- des activités sociales ou de stimulation cognitive pour éviter l’isolement
Si le domicile n'est plus approprié ou que l'isolement pèse sur votre parent, des solutions d'hébergement intermédiaires existent. Elles offrent un bon compromis entre indépendance et sécurité. Vous pouvez vous renseigner sur les résidences autonomie (les anciens foyers logements) ou les résidences services seniors. Ces lieux de vie proposent des appartements privatifs avec des espaces et prestations communes (restauration, animations).
L'entrée en établissement spécialisé de type EHPAD peut être envisagée dans certaines situations plus complexes. Un accueil temporaire peut aussi être une option à considérer si l'état de santé de votre parent nécessite une surveillance médicale continue ou si sa perte d'autonomie s'aggrave, rendant la vie à domicile trop difficile, même avec des soutiens.
Conclusion
Comprendre le GIR 3 est une première étape. Ce n'est pas une finalité, mais plutôt le point de départ d'une nouvelle organisation pour votre parent. Il est important de connaître les options pour mettre en place un accompagnement approprié et préserver son bien-être.
L'information principale à retenir est que le GIR 3 ouvre le droit à l'Allocation d'Autonomie (APA). Ce soutien est le pilier qui permet de financer un programme sur mesure : présence d'une assistante de vie, portage de plats, ou encore aménagement de l'habitation. C'est un levier concret pour sécuriser la vie de votre parent.
Vous disposez maintenant des repères pour naviguer dans ce parcours. Le classement GIR est un outil, pas une étiquette. Il vous donne, en tant que proche aidant, les moyens de prendre des décisions éclairées pour organiser la vie à domicile ou choisir une solution satisfaisante pour la personne que vous accompagnez.
À retenir :
- Le GIR 3 signifie une perte d’autonomie partielle, surtout physique, mais avec les facultés mentales préservées.
- Il ouvre droit à l’APA, dont le montant maximum est de 1 143,09 € par mois (2024), avec une participation selon les revenus.
- D’autres aides existent (crédit d’impôt, caisses de retraite, CCAS, Anah).
- Les solutions privilégient le maintien à domicile, mais des alternatives comme les résidences autonomie ou services seniors existent.
- Le rôle des proches aidants est central pour accompagner les démarches et adapter l’environnement de vie.
Ressources à lire
Découvrez nos conseils pour le maintien à domicile.
Votre proche à domicile plus longtemps.
L’équipe YesHome au service de votre famille.


À Paris et Rouen.
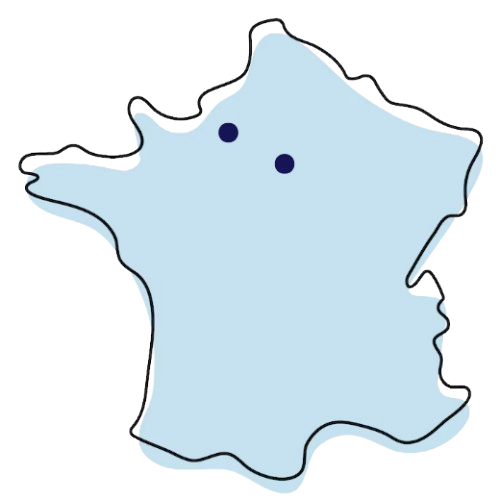

%20(1).png)





